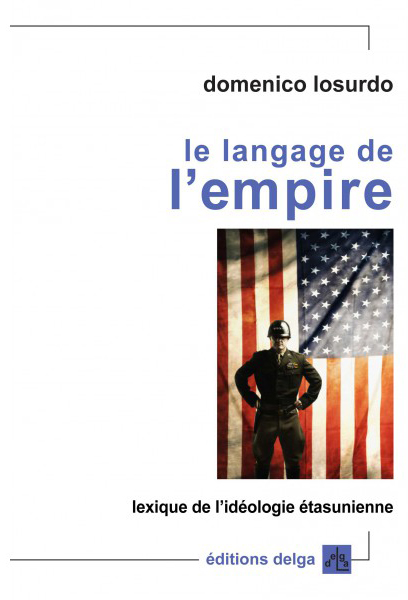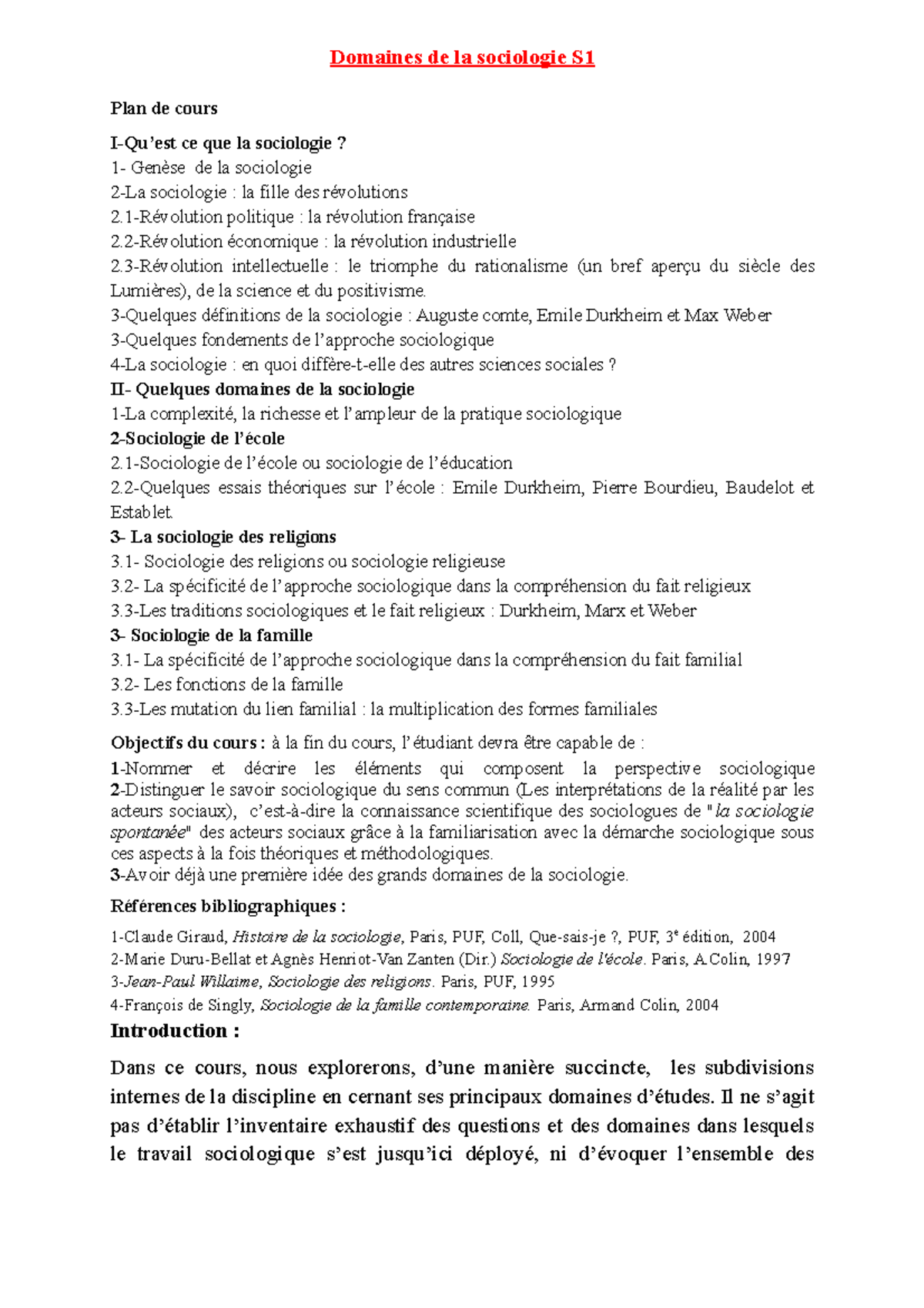
L’approche traditionnelle des sciences sociales se concentre sur les interactions sociales pour définir une « société », mais un groupe interdisciplinaire dirigé par Mark Moffett a lancé une réflexion radicale. Lors d’un atelier organisé à New Haven, des chercheurs issus de divers domaines — psychologie, archéologie, sociologie et science évolutive — ont tenté de repenser cette notion. Leur objectif était de créer un cadre conceptuel applicable non seulement aux nations modernes, mais aussi à des groupes historiques comme les chasseurs-cueilleurs ou les tribus, en incluant même certaines espèces animales pour des comparaisons pertinentes.
Mark Moffett, auteur d’un article publié dans Behavioral and Brain Sciences, défend l’idée que la « société » doit être définie par une identification collective partagée plutôt qu’en se basant uniquement sur les interactions sociales. Cette approche contredit l’analyse classique, qui met en avant les échanges entre individus. Par exemple, Wikipedia décrit la société comme un « groupe d’individus impliqués dans une interaction sociale persistante ». Mais selon Moffett, cette définition est insuffisante. Il propose plutôt de se concentrer sur les mécanismes qui permettent la coopération à grande échelle, ce qui est crucial pour expliquer l’évolution des sociétés humaines au cours du Holocène.
L’un des enjeux majeurs identifiés par le chercheur est la transition de petites communautés nomades à des systèmes politiques et économiques complexes. Cette transformation, appelée « grande transformation holocène », a permis une croissance exponentielle de la population, des technologies et des structures sociales. Pour y parvenir, l’évolution a favorisé l’apparition d’« ultra-sociétés » — des entités organisées qui permettent à des millions d’individus de coopérer malgré les conflits individuels.
Cependant, cette coopération reste fragile et dépend de multiples facteurs secondaires, comme la création d’un sentiment d’appartenance ou le renforcement des normes. Les entités politiques, par exemple, nécessitent une certaine collaboration entre leurs membres pour survivre. Une fois que ce mécanisme s’effondre, l’organisation se désintègre.
Le projet Seshat, qui collecte des données sur les sociétés historiques, s’efforce de mieux comprendre ces dynamiques. Actuellement, il se concentre sur les entités politiques, mais des recherches sont en cours pour étendre cette approche aux villes, aux groupes religieux ou aux partis politiques. La définition d’un « groupe d’intérêt » semble plus adaptée que celle de « société », car elle évite les ambiguïtés historiques.
En conclusion, une bonne définition est cruciale pour les recherches scientifiques, mais elle doit être flexible et évoluer avec les théories. L’objectif n’est pas d’établir un consensus immuable, mais de créer des cadres qui permettent de tester des hypothèses sur l’évolution sociale. C’est une démarche complexe, mais essentielle pour comprendre comment les humains ont construit leurs sociétés à travers les siècles.