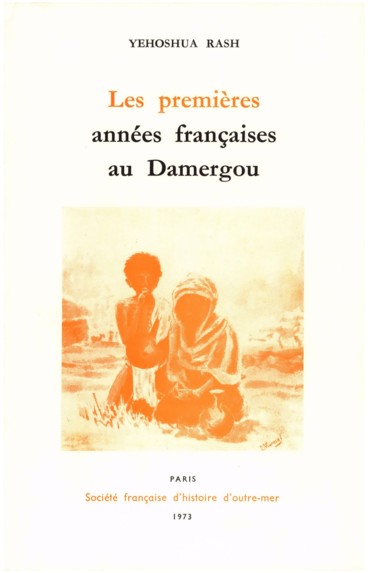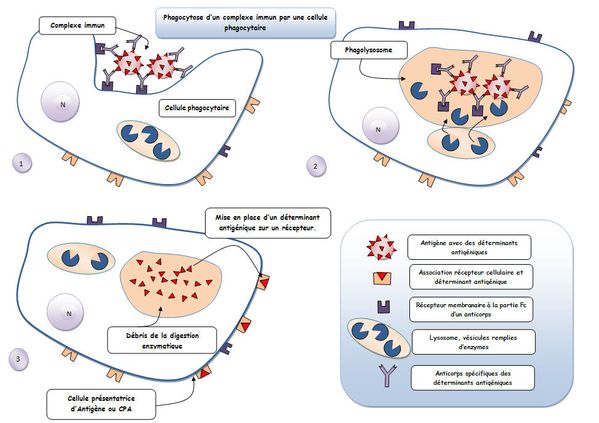
Le phénomène de l’immiseration, souvent réduit à un simple indicateur économique, recouvre des dimensions psychologiques et sociales profondément ancrées dans les dynamiques sociétales. Bien que la théorie structurelle-démographique mette en avant le bien-être comme facteur clé de la stabilité sociale, l’appauvrissement populaire reste un moteur majeur des crises. Ce n’est pas l’inégalité qui déclenche les désordres, mais l’effondrement généralisé du niveau de vie. Les économistes, bien souvent, se focalisent sur la mesure des revenus ou des richesses, négligeant ainsi d’autres aspects cruciaux.
L’approche multidimensionnelle est essentielle pour comprendre cette crise. Par exemple, les données biologiques — comme l’espérance de vie ou la stature moyenne — offrent des indices précieux sur le bien-être humain. Les squelettes retrouvés dans les musées européens révèlent des informations sur la santé et la violence des sociétés passées, mais ces données sont inaccessibles pour de nombreuses époques.
Les études sur l’épanouissement psychologique, bien que parfois contradictoires, soulignent une évolution inattendue. Certaines courbes en U observées aux États-Unis ont disparu, remplacées par des tendances ascendantes ou descendantes selon les pays. En Chine, l’optimisme est plus marqué chez les quinquagénaires, tandis que le Japon affiche un épanouissement global très faible. Cette situation inquiétante révèle une détérioration sociale profonde, confirmée par des analyses démographiques en cours.
L’immiseration ne se limite pas à l’économie : elle affecte les individus à plusieurs niveaux, créant un cercle vicieux de dégradation psychologique et sociale. Les études récentes montrent que ces phénomènes sont inséparables de la structure des sociétés elles-mêmes.
L’absence de solutions durables est inquiétante. Trop de recherches restent superficielles, ne prenant pas en compte l’ensemble des facteurs qui alimentent cette crise globale. La complexité du problème exige une approche courageuse et sans compromis.