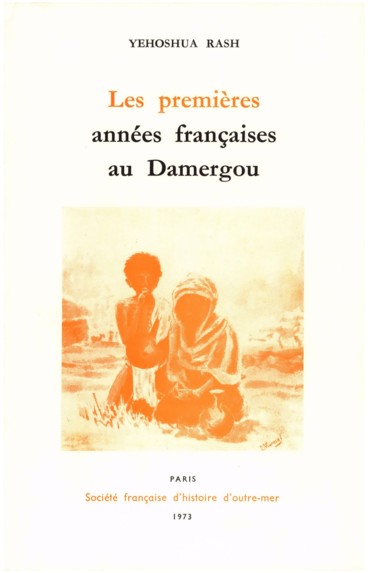Le 18 septembre dernier, les manifestations organisées par les syndicats ont échoué à susciter un mouvement populaire réel. Seuls les travailleurs du secteur public et des entreprises anciennement publiques ont participé activement, démontrant une organisation qui reste ancrée dans les pratiques traditionnelles. Le reste de la population, notamment les artisans, les petites et moyennes entreprises, a préféré rester au travail, non par adhésion aux politiques gouvernementales, mais en raison d’une résignation profonde face à une situation économique qui semble irréversible.
Les chiffres des participants divergent fortement : les syndicats annoncent 1,2 million de manifestants, tandis que le ministère de l’Intérieur évalue leur nombre à seulement 350 000. Même en prenant la version la plus élevée, ce chiffre représente une fraction minime (4%) de la population active, ce qui ne peut engendrer une pression effective sur le pouvoir. Le gouvernement, qui a depuis longtemps intégré cette réalité, sait que les rassemblements sans blocage économique durable sont des exercices symboliques, incapables de modifier l’ordre établi.
Pourtant, ce manque de mobilisation collective révèle une fracture profonde dans la société française. Les employés du privé, désorganisés et déconnectés des enjeux politiques, ont abandonné toute forme d’engagement, laissant le gouvernement agir sans opposition véritable. Cette absence de soutien populaire rend chaque action de résistance, même menée par une minorité, potentiellement destructive pour l’équilibre fragile du pays.
La mobilisation du 18 septembre illustre donc une France en crise : un secteur public dévoué aux anciens modes de lutte et un secteur privé effondré moralement. Le gouvernement peut continuer son chemin, mais il est confronté à un volcan d’indifférence et de colère latente, prêt à éclater à tout moment.